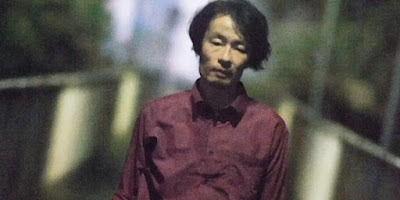Showing Up de Kelly Reichardt (2022).
Le grunge et l'esprit du pionnier.
Qui dit Portland, Oregon, dit le Nord-Ouest américain. Or le Nord-Ouest américain, ce ne sont que deux Etats, l'Oregon, donc, et son voisin du dessus, l'Etat de Washington, deux Etats difficilement dissociables, d'autant qu'à l'origine ils ne faisaient qu'un, et que Portland, la ville de Kelly Reichardt (et de Jon Raymond, son scénariste attitré), se trouve à la frontière des deux (il n'y a que le fleuve Columbia à traverser). Et qui dit Nord-Ouest dit grunge — via Washington, l'Etat, et Seattle, la ville de Kurt Cobain — mais pour Reichardt le grunge surtout en tant que style, un style dont Showing Up me semble revêtir (c'est le mot) toutes les caractéristiques. Par ce côté minimaliste que la cinéaste n'a peut-être jamais poussé aussi loin (au niveau de la forme comme du récit, fait de microfictions: ici, nourrir un chat, s'occuper d'un pigeon blessé, rendre visite à un frère psychiquement malade... la réalité du quotidien, comme celui des pionniers dans Meek's Cutoff ou du petit groupe terroriste dans la première partie de Night Moves). Un maxi minimalisme, pourrait-on dire, rappelant la deuxième histoire de Certain Women et bien sûr Wendy & Lucy, déjà avec Michelle Williams, qui en est donc à sa quatrième collaboration avec Kelly Reichardt, autant dire qu'elle est bien son actrice fétiche, sinon son double, après avoir incarné Wendy (se déplaçant avec son chien), Emily (faisant l'épreuve de l'Autre), Gina (témoignant de sa mélancolie) et maintenant Lizzy, une artiste-sculptrice préparant son exposition et dont le quotidien parasite le travail). L'aspect grunge du film commence avec la dégaine de l'actrice (fringues informes, aux coloris ternes, assortis à la terre qu'elle utilise pour ses sculptures, chaussettes tombantes et crocks — qu'elle remplace par des babouches quand elle sort!) (1), se poursuit à travers les sculptures elles-mêmes (des figurines en céramique, d'allure féminine, travaillées grossièrement et à l'expression aussi étrange qu'inquiétante), dont le générique de fin nous apprend qu'elles sont l'œuvre d'une artiste de Portland, Cynthia Lahti (une amie de Jon Raymond), et se propage à tout l'environnement disons "rudimentaire" du film, de l'atelier-garage (à demi ouvert) de Lizzy à l'espèce de "fourre-tout" artistique que représente le campus, où sont déclinées toutes les activités créatives possibles, du dessin au macramé en passant par la poterie et le métier à tisser... soit le côté arts and crafts de Showing Up, à l'instar d'une autre artiste basée à Portland, Jessica Jackson Hutchins, dont le travail — Reichardt en a fait un court-métrage: Cal State Long Beach, CA, January 2020 — repose sur l'assemblage d'objets usagés (cf. Lizzy au tout début du film récupérant des rebuts dans la rue) et l'utilisation, entre autres, du fil de fer et du papier mâché ("showing" résonne phonétiquement comme "chewing": se montrer, s'exposer, mâché, mastiqué, avec ce qui nous entoure, notre environnement de tous les jours). Et la dimension d'utopie qui, à la base, sous-tend ce type de mouvement (destiné au départ à l'ouvrier-artisan mais qui s'est par la suite généralisé, vu que tout le monde peut être créatif, dixit Lizzy), mouvement prônant ainsi le recours à des matériaux naturels, la fabrication fait main et bien sûr l'inventivité (j'ai bien aimé la fille et sa combinaison multicolore décidant d'y adjoindre des scratchs plutôt qu'une fermeture éclair). Dans ce monde saturé de couleurs qu'elle côtoie plus qu'elle n'en fait partie, Lizzy, personnage "gris", grunge, à l'univers triste, fait tache évidemment. Elle représente le contrepoint, nécessaire au film pour lui éviter un aspect trop lisse, mais en même temps douloureux pour ce personnage désireux quand même d'égayer sa vie (trop centrée sur une famille passablement déréglée), à l'image de ses créations auxquelles Lizzy a fini par ajouter de la couleur, comme lui fera remarquer son père, lui-même ancien céramiste (personnage fantasque auprès duquel elle semble rechercher une reconnaissance, du moins artistique).
La beauté ingrate de Showing Up réside dans cette espèce de bloc glaiseux dans lequel se trouve prisonnière Lizzy (Michelle Williams, extraordinaire comme d'habitude) et dont elle voudrait s'extraire, la libérant de ses frustrations qui la rendent si peu aimable (deux demi-sourires en tout et pour tout dans le film, liés à son travail d'artiste: quand les sculptures sortent du four et que la cuisson s'est bien passée, puis à la fin, lors du vernissage, quand le père observe les sculptures et semble les apprécier). Le personnage, bien qu'au centre du film, y est comme effacé, sans relief, surtout par rapport aux deux extrêmes que sont Sean, le frère halluciné, génie créatif d'après la mère, mais qui ne fait rien hormis regarder de vieilles séries à la télé et se cuisiner des pâtes "bolo", jusqu'au moment où, au plus fort de ses hallucinations, il se met à creuser un énorme trou dans le jardin, en quête, on l'imagine, de ces voix qui l'assaillent et qu'il appelle "les bouches de la terre"; et à l'autre bout Jo, la voisine asiatique (au tempérament cool), artiste elle aussi, mais à un niveau supérieur, presque professionnel, créant des installations que je qualifierais volontiers de solaires (les œuvres, faites de laine et de papier, sont celles de Michelle Segre qu'on peut voir au travail dans un autre court-métrage réalisé par Reichardt: Bronx, New York, November 2019) et qui loue à Lizzy la maison d'à côté, personnage à l'imagination toujours en éveil (cf. le travelling du début qui la suit dans la rue en train de faire rouler un pneu jusqu'à son jardin pour ensuite le fixer à la branche d'un arbre et en faire une balançoire). La tension du film — toujours minimum chez Reichardt mais suffisamment présente pour qu'on y ressente cette impression de "douce violence" qui sourd de ses films — porte ainsi sur ces deux "forces" opposées qui pèsent sur Lizzy, resserrant un peu plus l'étau affectif à quoi ressemble sa vie, à l'image du pigeon blessé, emmailloté dans sa boîte (le pigeon, animal grunge par excellence, au sens propre du terme, si je puis dire, dont il faut régulièrement changer le papier sali de la boîte). Bref, d'un côté, l'horreur de la folie, qui atterre Lizzy quand elle voit son frère s'enfoncer de plus en plus dans la folie; de l'autre, l'émulation que suscite le compagnonnage de la voisine, en même temps que s'y mêle un sentiment confus d'admiration et de jalousie, vu que tout semble lui réussir, ce qui pour Lizzy rend d'autant plus insupportable le fait que, faute de temps, Jo traîne des pieds pour faire réparer la chaudière, la privant d'eau chaude tout le long du film (c'est le running gag de Showing Up — le showering up — qui voit Lizzy plusieurs fois obligée d'aller prendre une douche à l'extérieur).
Et le Nord-Ouest dans tout ça? En dehors du grunge et de la géographie. Eh bien — mais là vous n'êtes pas obligés de me suivre — il apparaît à deux niveaux. Dans les deux images citées plus haut. D'abord celle des "bouches de la terre" qui confère au geste de Sean, si insensé soit-il, un côté "fouille" (the dig), l'image même, métaphorique, du retour aux sources, aux mythes fondateurs, de cette quête des origines qui traverse le cinéma de Kelly Reichardt. Puis l'image de la balançoire (the swing), que confectionne Jo avec son pneu (une image et son origine — le geste de Jo faisant rouler le pneu — que reproduira Lizzy dans une de ses sculptures). Difficile de ne pas y voir l'évocation nostalgique d'un territoire perdu, celui de l'Oregon Country, cet Oregon originel qu'arpente (en rêves) K.R. dans tous ses films (depuis Old Joy), quels que soient les genres abordés... genres qu'on peut regrouper en un seul, le genre north-western. Dig & Swing. Creuser, se balancer... Et ainsi plonger plus profondément dans un monde aux couleurs naissantes, encore tremblant, celui que poursuit l'artiste du Nord-Ouest, via cet "esprit de pionnier" qui lui est propre. Est-ce ce monde que finit par apercevoir Lizzy à la fin, dans le ciel de Portland, après que Sean a libéré le pigeon et que, accompagnée de Jo, elle cherche l'oiseau des yeux. Le film ne le dit pas, mais oui peut-être...
(1) Etant entendu que le "vrai" grunge (question fringues), c'est dans Wendy & Lucy que Michelle Williams le portait.
Sur le cinéma de K. Reichardt, cf. Kelly Reichardt et le Nord-Ouest: une ode.