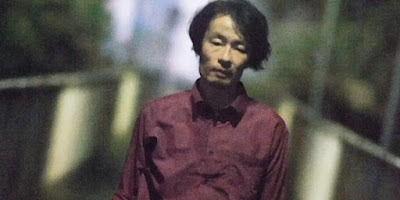Chime de Kiyoshi Kurosawa (2024).
Le cinéma de Kiyoshi Kurosawa, on le sait, file allègrement la métaphore, à l'image de ses deux derniers films, Chime et Cloud (2024) — je passe sur la Voie du serpent, pâle démarcation du second, plus précisément de la seconde partie, dans le hangar, parce qu'à la sauce française, rappelant le style des vieux téléfilms français, qui ne tient que par le comique involontaire que produit (à l'instar du personnage joué par Damien Bonnard) le côté pataud de la mise en scène... nous rappelant surtout que loin de ses bases, comme avec le faiblard Secret de la chambre noire, le cinéma de Kiyoshi Kurosawa perd beaucoup de son inspiration et de sa vitalité.
Donc Chime et Cloud qui, eux, filent de manière autrement plus convaincante la métaphore: culinaire dans le premier, "nébulesque" dans le second...
Les ondes Kiyoshi.
Chime, par son haut degré d'abstraction, est un drôle d'objet, un objet en l'occurrence métallique qu'on aurait soumis à des radiations sonores (le "carillon" du titre, proche du bourdon), de sorte que le rapport à la cuisine, s'il passe d'abord par l'art de la coupe dans la cuisine japonaise (et le rôle qu'y joue le couteau, ici pour couper des oignons ou découper un poulet, véritable support de série B, genre slasher)... n'ouvre pas pour autant sur un quelconque art de la table (kazirigiri), avec ce que cela suppose de raffiné et d'harmonieux; annonçant au contraire les dissonances qui sied si bien à l'art de Kiyoshi Kurosawa. Comme si le plat tout juste préparé, loin d'être subtilement cuisiné, était passé directement au micro-ondes... des ondes mystérieuses, inquiétantes, et probablement terrifiantes, elles-mêmes découpées (à l'image des lumières du métro aérien), par moments envahissantes, à d'autres étrangement absentes (comme tapies dans un monde devenu subitement sourd), mais au bout du compte, promptes à s'immiscer partout (via des passerelles), dans tout l'environnement ambiant, jusqu'à l'espace domestique — cf. le bruit que font, lorsqu'on les décharge, ces sacs gigantesques remplis de canettes vides... le son ultra-contemporain de la folie consumériste, emblématique du Japon, et plus généralement du non-partage (égotiste) qu'incarne le personnage principal (enseignant dans une école de cuisine), plus apte à parler de lui que de ce qu'il pourrait apporter aux autres (en tant que chef cuisinier). Si le message peut paraître simpliste, il n'en demeure pas moins parfaitement raccord avec le minimalisme de la mise en scène et, dans le cas présent, la durée du film, qui ne dépasse pas les trois quarts d'heure. Aussi dirais-je que Chime n'est pas, comme certains le regrettent, un film trop court, un "Kiyoshi pas entier", ajouterais-je pour filer une fois encore la métaphore culinaire (d'autant que la cuisine ici n'avait finalement rien de japonaise, on y parlait aussi de cassoulet!), mais un parfait concentré (sans tomates) de l'art pour le moins diététique de maître Kiyoshi.
Théorie du nuage.
Quant à Cloud, de quoi s'agit-il? D'abord de stockage. Car qui dit "cloud" dit stockage, sur des serveurs virtualisés, renvoyant donc à une réalité virtuelle, celle du commerce en ligne, sauf qu'il s'agit aussi de récupérer la marchandise et de la stocker physiquement dans un entrepôt, Kurosawa jouant de ce double mouvement de la marchandise, des rayonnages métalliques sur lesquels elle est remisée, à l'écran de l'ordinateur où elle figure virtuellement, permettant à Yoshii de suivre l'évolution de ses transactions (hautement spéculatives). D'où il ressort, via la manière dont le héros range ses caisses en carton, comme il classe ses dossiers sur son PC, une sorte d'art de la méthode, qui voit la marchandise entreposée de façon à optimiser l'espace disponible, à la manière dont on procède sur un ordinateur (Yoshii est de plus aidé par un "assistant", comme on en trouve dans les programmes informatiques). Méthode qu'on ne saurait toutefois rattacher à l'art japonais du rangement (danshari) — marqué, outre le minimalisme, par sa philosophie de la réduction (de tout ce qui est superflu et encombre) — dans la mesure où ici (la première partie du film) les transactions témoignent d'un matérialisme outré et sans scrupules (dont Yoshii est devenu dépendant, fonctionnant dans le plus-de-jouir), et d'autant plus qu'il se trouve encouragé par l'"assistant" (qui, lui, agit comme pousse-au-crime)... un matérialisme que symbolisent les grandes entreprises du web (la métaphore est là, les caisses en carton renvoyant à Amazon et tous ces sites de vente en ligne), ce qu'il va "payer au prix fort" dans la seconde partie, Cloud virant brutalement au film de vengeance (vengeance ourdie par ceux, clients ou partenaires, que le héros, à travers son business, a humiliés, trahis ou arnaqués). Soit le retour du réel, dans ce qu'il a de paradoxalement "irréel" (les victimes de ce matérialisme "débridé", se sont mués en purs psychopathes), vu que, comme dans la première partie, réel et virtuel demeurent enchevêtrés: l'extermination des assaillants, un par un, dans le hangar rappelle autant les films de home invasion (de Assault on Precinct 13 de Carpenter à Knock at the Cabin de Shyamalan) que des jeux de tir sur PlayStation (jeux au demeurant addictifs, aussi addictifs que peut l'être l'e-commerce, d'où la longueur de la seconde partie). Et le nuage, me direz-vous? Eh bien, il est dans l'obscurcissement qui gagne progressivement le film par la violence qui s'y déploie — les nuages s'amoncellent dans le ciel, dit un des personnages — jusqu'au finale où Yoshii, condamné à poursuivre son travail de revendeur compulsif, et ainsi nourrir une jouissance de plus en plus mortifère (de celle qui peut détruire le monde), se retrouve comme perdu au milieu des nuages — des nuages à la picturalité marquée, telle une fantasmagorie —, prêt à franchir les portes de l'enfer (consumériste). Fade to black.